Un pouvoir armé est-il légitime ?
Par François HOUSSET | Les Textes
#48
| commenter
|  |
| 
Tout pouvoir contraint, et le gouvernant ne gouverne qu’en tant qu’il oblige. C’est sous la menace que les citoyens obéissent aux lois, et non en vertu de leur bonne volonté (idéale !). Tous tremblent devant les “gardiens de la paix”, dans les pires dictatures comme dans les meilleures démocraties.
Nous avons la chance de vivre dans un État où les sanglantes répressions sont assez rares pour être considérées en tant que bavures. La répression est-elle si mesurée parce que nous sommes de “bons citoyens” n’ayant pas à être contraints, ou parce que nous n’osons pas désobéir ?
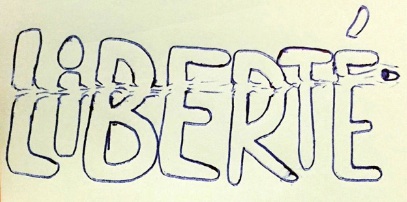
Quelle bonne âme aurait assez de civisme pour éviter toute faute sans que “la peur du gendarme” l’y contraigne ? Si c’est la peur qui fait le citoyen respectueux (aussi douce et invisible soit la menace qui le tient dans le droit), c’est bien à la condition de masquer une part importante de lui-même que le pouvoir reste tolérable.
Si la crainte est effectivement nécessaire, aucun pouvoir ne peut s’en passer, et c’est la force qui fait le droit. Alors nous apparaît toute la perversion de ce qui rend un pouvoir légitime. Le respect que nous feignons devoir à l’autorité devant laquelle nous nous courbons n’a rien d’une vertu morale. Tenir en respect signifie menacer d'une arme. Nous ne sommes jamais que tenus en respect comme des bêtes féroces menacées par leur dompteur : l’ordre ne fait pas appel à la bonne volonté quand il se fait respecter. Tout au contraire d’une adhésion intime, il est un affront brutal, et bientôt à main armée. Dès lors, la violence est imminente. On a beau jeu d’évoquer la ferveur de l’âme et sa foi la plus profonde, quand il ne s’agit que de la fureur d’un pouvoir démontrant sa force.
Si nous voulons approcher l’énigme de l’incroyable force du respect que nous avons pour l’autorité, il faut tenter de remonter à ce qu’a du être l’action primitive du respect, avant son état accompli. Autrement dit, il faut régresser à la genèse du sentiment, retrouver la situation dans laquelle le respect n’est pas du tout une noble et belle idée, mais en chair et en os une puissance fauve qui en effet nous force absolument. C’est ce qui arrive lorsque parfois nous sommes déchirés entre un désir irrépressible et une défense irrésistible. L’envie terrible d’attenter au corps ou à l’âme d’autrui bute contre l’effroi terrifiant qui paralyse notre impulsion. C’est ainsi que l’ignominie de certaines concupiscences rencontre un absolu interdit dans ce qui est pourtant la plus vive excitation. Alors il faut bien dire que le sentiment du respect procure en effet l’extrême sensation glaciale d’un revolver sur la tempe ou d’un rasoir sur la gorge : il nous tient bel et bien, physiquement, en respect, car nous sentons parfaitement que le passage à l’acte serait notre mise à mort morale, mentale, ou physique. C’est ainsi que tourne court l’envie folle de transgresser ce que la conscience nous impose de respect. La transgression, c’est-à-dire le viol de l’humanité, nous assure la peine capitale de nous en exclure. La transgression ferait de nous un animal épouvantable, et qui ne pourrait plus vivre en sa conscience perdue. Rien donc n’est plus absolument violent que la contrainte du respect, contrainte par corps dans un extrême rapport de force.
La soumission du désir au devoir ne peut se faire que sous la menace. L’obéissance à la loi est un impératif, un gibet qui nous promet de finir au bout d’une corde si nous ne faisons pas preuve de docilité. Ainsi, ce que dans nos passions les plus morbides nous disons et nous souffrons plus fort que nous, trouve un maître encore plus fort, mieux armé et entraîné : la puissance du respect doit être insurpassable, pour que les humains vivent ensemble. Ils ne se supportent que parce que tous sont inévitablement soumis à cet absolu pouvoir de contenir ce qui, sinon, serait incoercible.
François Housset
www.philovive.fr
à ce propos
Aristote Politique. Livre 3, chap. 17 : “par nature, les hommes sont destinés à être gouvernés despotiquement” (Aristote vante les avantages du despotisme sur la démocratie : la démocratie est trop pervertie pour que ce soit la loi qui régisse les hommes ; aucune loi ne peut plus valoir quand c’est bien le peuple qui gouverne, c’est-à-dire exerce au jour le jour et dans chaque cas particulier sa liberté capricieuse. La démocratie finit inévitablement en démagogie, et les désirs insatiables prennent le dessus : les “souverains de l’opinion du peuple”, qui savent retourner leurs vestes, flatter et agir en méprisant l’intérêt véritable de la Cité, ne font pas de politique, parce que “partout où les lois ne gouvernent pas il n’y a pas de constitution”. Ce n’est que parce qu’il est despotique que le pouvoir relève de l’ordre politique !
Montesquieu L’Esprit des lois. Livre III, chap. IX : le principe du gouvernement despotique est la crainte. Le despote règne par la terreur, mais lui-même, craignant pour son pouvoir et pour sa vie, est condamné à ne cesser, pas un instant, de se faire craindre. Il n’est pas vrai qu’il existe des despotes libéraux, éclairés ou humanistes. Car l’homme qui tremble est une bête traquée, qui perd les sentiments humains. Le civisme et l’estime de soi, qui font les sociétés humaines, ne peuvent exister dans un régime despotique. Le gouvernement despotique, parce qu’il déshumanise les hommes ressemble à une froide machine, qui ne peut cesser de faire trembler sans cesser d’être. Livre IV chap. IV : montre un beau paradoxe : dans la tyrannie, il n’y a plus de maître, vu que le tyran est en même temps esclave : vivant dans l’oppression permanente d’un complot, il n’a pas la liberté fut-ce de baisser les yeux : les hommes soumis ne plient que tant qu’ils sont sous son joug, et profiteront du moindre faux-pas de leur maître pour se libérer de leurs chaînes.
Hobbes. Leviathan. La domination est l’essence même de l’ordre politique. Le peuple s’engage à respecter un contrat unilatéral, qui n’engage que le peuple -pas le gouvernant, qui de fait est leur maître. L’ordre politique est au prix d’un pouvoir absolu du souverain. Une souveraineté ne se partage pas, elle est nécessairement une et indivisible, supérieure et extérieure au peuple, implacable donc efficace.
Rousseau : Contrat social, livre I, chap.III : “Du droit du plus fort” Le plus fort n’impose sa domination au plus faible qu’autant de temps qu’il est le plus fort. Le jeu des forces se réduit strictement à ce qu’il est : la loi de la force est que le plus fort ne l’est pas toujours. Telle est la faiblesse de la force que, réduite à sa réelle nature, purement physique, elle ne contient en elle-même aucune détermination morale, politique. “Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement ; et, puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit toujours le plus fort. Or, qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse ?” Telle est la faiblesse de la force qu’elle ne tient sa force que de son application actuelle ; sitôt qu’elle se détourne ou relâche, celui qui la subissait reprend dans l’instant le dessus. Dès lors, la force est dans la nécessité, pour masquer sa faiblesse, de se couvrir de l’apparence extérieure du droit. “Le droit du plus fort” est une formule embrouillée à dessein pour faire illusion. Elle ne trompe que l’imagination. Elle ne résiste pas à l’examen critique : on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes, parce que l’obéissance et la contrainte s’excluent réciproquement. Il n’y a dans l’obéissance que la pure volonté d’obéir ; il n’y a dans la contrainte que la pure nécessité physique. Il faut donc rejeter le galimatias confus des force morales.
“Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique... Il faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste... ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.” Pascal. Pensées 298.
“Puisqu’aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes.” Rousseau, Contrat Social, I, chap IV
Liens internes :
- La philosophie de la guerre prépare-t-elle la paix ?
- L'abus de pouvoir
- Doit-on tolérer l'intolérance ?
- La haine
- Tu aimeras ton prochain comme toi-même
- La responsabilité
- L'homme est un mouton pour l'homme
- Un seul peut-il avoir raison contre tous ?
- Maîtrise de soi et des autres
- Pourquoi la guerre ?
- Justifier la violence
- Peut-on se passer de maître ?
- A quoi sert la culpabilité ?
- La souffrance comme moteur de la vie
- La fabrique de violence
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire