Permettre à l’Autre d’être là !
Par François HOUSSET | Les Textes
#88
| 2 commentaires
|  |
| 
“Ce n’est plus lui”, “ce n’est plus elle” : c’est vrai, et ça n’est pas vrai...
Doit-on admettre la dégénérescence spirituelle comme inexorable ?
Doit-on appréhender le malade comme il est ?
Comme le personnage qu’il était ?
Comment respecter son autonomie fragilisée ?
Quelle information diagnostique révéler, quel pronostic faire qui ne soit un verdict ?
Qu’est-ce qu’une prise en charge juste, respectueuse de tous ?
La maladie d’Alzheimer “rappelle” la valeur et la fragilité de l’identité qu’on perd en perdant la mémoire. Être conscient, c’est savoir que l’on subit quelque chose, et pouvoir y réagir, se penser soi-même comme sensible des phénomènes qui nous entourent. C’est encore -et surtout- se situer dans le temps. Il n’y a de temps que pour une conscience qui constate qu’il y a des choses qui ont été, qui sont, qui seront. La conscience est une unité qui ne change pas car si on change devant le changement on ne peut avoir conscience du changement. La représentation du changement implique une permanence, elle impose la mémoire. Perdre la mémoire c’est donc se perdre.
“Conscience signifie d’abord mémoire (...). Une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s’oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant : comment définir autrement l’inconscience ? (...) toute conscience est donc mémoire, conservation et accumulation du passé dans le présent.”
Bergson, “La conscience et la vie” (1911), in L’énergie spirituelle, P.U.F.

Il y a des progrès. La recherche avance, la prise en charge s’améliore, mais la maladie aussi progresse (il y a déjà en France cent fois plus de malades d’Alzheimer que de malades du SIDA), et notre population vieillit à vue d’œil... Ces faits sont faciles à constater, mais qu’en est-il de la personne qu’on reconnaissait à son caractère, à ses “qualités”, et qui ne les a plus ? Il est “normal” de pleurer un ami perdu quand la mort nous l’a enlevé... mais quand il est toujours là, avec “seulement” une conscience altérée qui ne lui permet plus de nous reconnaître ? Quand il a oublié son propre nom ? Celui qu’on connaissait n’est-il pas mort au sein de ce corps pourtant vivant ?
La solution de facilité consisterait à le considérer comme mort mentalement. Et en faire le deuil. Or cette personne existe encore. Elle a perdu certains traits de caractères qui permettaient à ses proches de dire : “je te reconnais bien là”. Elle a simplement changé. Elle n’a plus le même statut (en a-t-elle encore un socialement, quand elle est sous tutelle et ne jouit plus de ses droits civiques ?), on va jusqu’à dire qu’elle n’est pas véritablement le sujet de ses actions : “ce n’est plus elle”... et pourtant elle est bien là !
Ce malade est-il encore “quelqu’un” ? Question immorale, scandaleuse pour tout humaniste, quand enfin les handicapés mentaux sont reconnus comme faisant partie de la communauté humaine. Question provocatrice, mais qui doit être posée pour lever l’ambiguïté rédhibitoire à une prise en charge juste et respectueuse. Question à poser et reposer encore quand la réalité horrifie : il y a trop de pratiques de marginalisation, d’exclusion, d’infantilisation, de réification (mot barbare qui signifie “transformer en chose”, pratique déjà trop courante en médecine quand on “soigne” Monsieur Ventre ou Monsieur Genou parce qu’il est plus pratique d’avoir affaire à des organes qu’à des personnes. (1) Mais ici on soigne des identités !
La science sans conscience est bien “une ruine de l’âme” (2), elle peine à appréhender cette personne “diminuée”, “handicapée d’humanité”, définie par la somme de ses pertes !
Le rôle du neurologue est délicat, il marche sur la frontière séparant la médecine en tant que science et en tant qu’art : son diagnostic révèle ce que la personne n’est plus. Il devra rappeler (notamment à l’accompagnant qui souvent souffre davantage que le malade) que cette personne a encore à vivre, qu’en elle persiste une véritable intériorité, une subjectivité, un regard -même s’il est troublé, même si ce n’est plus le même regard que celui qu’on lui connaissait depuis si longtemps.
« Le dément est un riche d'esprit qui est devenu pauvre, tandis que l'idiot a toujours été pauvre » Esquirol (1772/1840)
Comment ne pas infantiliser celui qui perd son autonomie ?
Difficile !
On ne peut traiter ce malade comme un fou : s’il perd ses capacités rationnelles, il en souffre beaucoup plus que celui qui en aurait toujours manqué, et le traiter comme un attardé revient à le déconsidérer.
Il faut se rappeler le respect qui lui est dû. Ne pas tutoyer d’emblée, frapper avant d’entrer… ne jamais oublier les gestes tout naturels quand on s’adresse à quelqu’un de « normal » : sinon il perd sa place dans la communauté.
Jusqu’où respecter sa liberté ? On est responsable de lui. C’est dire -hélas- qu’on répond pour lui. En se focalisant sur ses symptômes on oublie la personne, comme si elle n’existait déjà plus. Il faudrait afficher la Déclaration des Droits de l’Homme dans tous les “accueils” ! Mais ce serait pour ne pas l’appliquer, faute de moyens : la libre circulation des personnes, pour ne prendre que cet exemple, est inconcevable dans un centre d’accueil dont les portes sont closes, et où l’on n’autorise personne à sortir, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour accompagner ceux qui voudraient simplement aller où ils veulent. Il faut compenser l’interdit par l’affection : ne pas laisser croire au malade qu’il est puni, marginalisé, lui dire qu’il existe et que c’est important.
« je m’intéresse à vous ! »

Il peut sembler plus pratique de le prendre en main que par la main, mais là est le véritable danger. Méfions nous de la pseudo bonne conscience des équipes qui chosifient le malade une bonne fois pour toutes, en argumentant qu’il vaut mieux le laisser cloué dans son fauteuil « comme ça il ne tombe plus » que de lui permettre de marcher. Il ne tombe plus, parce qu’il n’existe plus, bien rangé dans son fauteuil avec lequel on le confond. La protection peut devenir carcérale, handicapante, néfaste pour le patient qu’on prive d’initiative. À trop vouloir l’aider il ne fera plus rien : il faut lui laisser la possibilité d’AGIR.
Si l’on supprime tous les risques qu’il peut courir en agissant spontanément, on l’oblige à devenir notre objet. Mieux vaut lui répéter mille fois l’endroit où il trouvera les toilettes que l’y emmener, l’y asseoir, le déshabiller… comme un enfant, comme un pantin...
Lui accorder ce droit est risqué : il tombera, se blessera, il se perdra, il échouera souvent, se détournera de ses objectifs...
Cette obligation de prendre des risques est un devoir qu’il faut expliquer à la famille.
Entre prise de risque et prise en charge, la difficulté est de trouver la juste mesure, qui fait toute l’éthique et la vertu de l’Homme (6). Ici le jugement de chacun est requis, car il n’y a pas de méthode éprouvée, pas de critère sinon le respect et la connaissance de l’Autre : chaque patient est singulier.
Le malade d’Alzheimer est « anormal » au sens où son intégration ne va pas de soi. Les malades ne forment pas un groupe homogène qu’on puisse considérer en énonçant des généralités : chaque individu est unique, sa singularité oblige chacun à une fantastique souplesse. On ne peut le normer, le faire entrer de force dans les cadres très rigides de nos préjugés comme de nos institutions. Mais on progresse, on s’humanise en cessant de ranger les malades : l’institution s’adapte enfin au patient (autrefois ce n’était jamais qu’au malade de s’adapter à l’institution).
AIDER L’AIDANT
Lui ouvrir l’accès aux informations sur les aides existantes.
Faire son éducation thérapeutique, par exemple dans le cade de groupes où l’on explique ce que c’est que cette maladie.
Rester accessible. Lui faire savoir qu’on est disponible pour accueillir à nouveau le malade. Cela rassure : « du simple fait qu’il sait qu’on est là, il demande moins d’aide »
Les soignants s’adressent à l'individu présent, à ses qualités actuelles. Leur attitude se distingue de celle des proches qui ont été confrontés au vécu de la perte et ont encore en tête son passé. Les proches s’adressent au malade comme à un parent (qu’il n’est souvent plus), un ami, un amour, avec lequel ils ont vécu une histoire. C’est un cheminement lent, une acceptation progressive de l’autre qui change… acceptation de l’inacceptable après une vie commune de plus de 50 ans ! Les proches se rattachent à leur histoire. Mais les soignants ne connaissent pas ce passé : ils prennent l’individu comme il se présente, souvent ils le prennent en charge du jour au lendemain. Aider l’aidant consiste à d’abord reconnaître sa vision du malade. Les familles ne cessent de présenter le passé du patient, de rapporter son histoire : « voilà ce qu’il a été ». De sorte que les patients sont confrontés à une perpétuelle présentation du résidant encore et toujours défini par ce qu’il n’est plus, par ce que la maladie lui a fait perdre. Si une biographie est utile, il ne faut surtout pas qu’elle se cantonne à l’historique des ravages de la maladie.
« Ce serait bien que dans la présentation du résident on ne parle pas de la maladie. »
Le proche est isolé, il vit mal la rupture relationnelle. Il lui faut accepter que sa relation change, il lui faut inventer de nouveaux modes de rapport. Certains n’y parviennent pas. Comment aimer cette personne dont l’intériorité s’évanouit : n’aimait-on que des qualités empruntées ?
“Celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté l’aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu’il ne l’aimera plus. Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s’il n’est ni dans le corps ni dans l’âme?... On n’aime personne que pour des qualités empruntées.” Pascal, Pensées.
Accompagner un proche atteint par la maladie d’Alzheimer est une véritable épreuve, qui réclame un amour éprouvé, un dévouement formidable. L’aimer quand même, par devoir, n'est pas une mince affaire. On a vite tendance à considérer cette charge comme une corvée. On doit payer sa dette (sinon on est « moche » dit Vernant, c’est-à-dire qu’on n’est plus rien parce qu’on ne fait pas ce qu’il faut). Payer, de soi-même, et sans rechigner : ce devoir est un bonheur qu’on s’accorde en s’acquittant de ce qu’on doit à l’Autre.
« Il faut l’aimer ! »
L’aimer… différemment… par devoir : “tu aimeras ton prochain comme toi-même” (3) dit notre loi morale, et cela doit aller de soi.
Décontenancés par la perte de l’Autre, certains confient leur perplexité aux soignants :
-Il ne me reconnaît plus ! Est-il bien utile que je revienne ? >-Oui, plus qu'utile, c'est nécessaire : il voit quelqu’un de gentil qui lui fait du bien, il apprécie votre présence. Même s’il ne sait plus qui vous êtes, il vous “reconnaît” comme ce bienfaiteur qui lui tient bonne compagnie.
RE-CO-NAISSANCES
Le devoir a ses limites : quel carburant ? Comment se payer de sa peine ?
”Ils nous reconnaissent. Et ils expriment beaucoup de reconnaissance : nous recevons des compliments toute la journée. ”
Dans la relation non-verbale, on se retrouve comme face à un bébé : chaque regard se donne entier, on vit une complicité dingue avec beaucoup d’éclats de rire, des moments très intenses .
”Notre soutien nous rapporte : beaucoup d’émotion, de véritable bonheur.
”Nous nous sentons fiers de redévelopper plein d’énergies, des événements qui marquent chacun, rattachent à la vie.
Exemple de gag : une patiente surgit dans le bureau :
« C’est ici Montparnasse ?
-Non Madame, c’est la station prochaine ! »
La voilà qui repart errer dans le couloir…..
Le bonheur des soignants est d’avoir pu manifester leur bonne volonté en améliorant le quotidien et les relations des couples. Leurs efforts sont souvent récompensés par les remerciements des familles qui reviennent après le décès du patient pour les remercier d’avoir réalisé ce départ dans les meilleurs conditions : chaleureuses.

Loin d’elle
Ce film présente une malade qui oublie son mari. Le pauvre homme l’accompagne malgré tout, non plus comme un mari accompagne sa femme, mais comme un visiteur inconnu suit une personne nouvelle ayant à vivre de nouvelles expériences...
Il s’agit de sauver le droit à l’espoir. Sans lui la vie perd sens : envisager la maladie d’Alzheimer comme une pure déchéance inexorable, ce n’est pas faire un diagnostic, mais un verdict. Il faut permettre à chacun de donner un sens à cette expérience : intégrer la maladie dans une trajectoire de vie... qui en vaille la peine.
La compétence du soignant n’est pas affaire de maîtrise technique, mais de sensibilité : il lui faut voir la personne au-delà de ses failles. Comment prendre en charge cette personne qui se perd ? L’expression “prendre en charge” peut choquer : n’est-ce pas déjà la considérer comme un fardeau ? Elle ne se porte plus elle-même ! Elle n’assume plus sa propre existence ! Disons qu’on doit l’aider, l’aider à mieux exister. Difficile : elle se replie dans une apparente indifférence. On est tenté de la prendre en main plutôt que par la main. Elle a besoin de respect, de sécurité, de communication (difficile aussi quand elle oublie le langage même : il faut trouver de nouveaux modes d’expression, retenir son attention qui se dissipe)... Elle est entravée dans sa capacité de penser, de se souvenir, de décider... mais elle est encore humaine. Elle a droit à un environnement humain.
”La madeleine de thé dans la tasse de Proust”

La mémoire n’est pas une mallette pleine de souvenirs, qu’on aurait (ou pas) à disposition, mais plutôt un tissu dans lequel chaque détail de son histoire est enchevêtré. Un souvenir resurgit quand un proche le rappelle ou quand un événement le tire du néant : c’est la Madeleine de Proust dans la tasse de thé (5)... Les souvenirs émergent parce que la situation les sollicite. Il faut tirer le fil : chaque souvenir se rattache à d’autres pour former le canevas d’une personnalité. Chaque souvenir est relié à un point de repère, tous sont entremêlés et se réfèrent les uns aux autres.

Qui dit mémoire dit relation. On le voit quand une vie active offre un second souffle au malade : il peut retrouver des aptitudes perdues, l’aggravation n’est pas inéluctable et dépend en grande partie de son environnement et de la qualité de ses relations. Un environnement affectueux éveille de multiples échos : chaque contact résonne et se relie à quantité d’autres qui résonnent à leur tour... le monde entier résonne...
"J'entends ta voix dans tous les bruits du monde" (Paul Éluard)Ce qui résonne raisonne. L’évolution de la maladie dépend avant tout du regard des accompagnants. Chaque occasion d’être relié à l’Autre, chaque attachement, chaque geste, chaque attention, sont une stimulation de la conscience même. Parce que le regard est le meilleur médicament, il faut croire en la richesse de chacun pour parvenir à une véritable re-connaissance. Le regard dynamique, voilà le “truc” qui fait le personnel motivé, l’accompagnant enthousiaste et, non seulement pour le malade, mais pour tout homme digne de ce nom, l’attachement aux choses importantes qui nous satisfont toute notre vie.
François Housset
www.philovive.fr
Merci au Réseau Mémoire Aloïs et aux laboratoires Lundbeck, qui m’ont donné l’occasion d’animer des débats sur ces thèmes.


(1)
Soin, qualité de vie et bonheur
(2)
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme
(3)
Tu aimeras ton prochain comme toi-même
(4)
Avant-premières du film Loin d’elle
(5)
Marcel Proust.Extrait de "Du côté de chez Swann"(passage sur la "madeleine de Proust")
(6) Soucieux de rendre à la morale le sens des situations concrètes et des conditions diverses de la vie humaine, Aristote analyse dans l'Éthique à Nicomaque, les multiples affections, dispositions, caractères et habitudes sur fond de quoi viennent prendre sens les différentes vertus, tant intellectuelles que morales. Chacune des vertus est une excellence consistant dans la «médiété», c'est-à-dire la juste mesure entre un excès et un défaut. Cette éthique de la juste mesure n'est pas une morale de la médiocrité. Elle affirme que le bonheur est l'équilibre harmonieux et humainement accessible de toutes les fonctions de l'âme et du corps, au sein d'une cité juste et dans des circonstances où puissent régner liberté, bien-être et amitié.
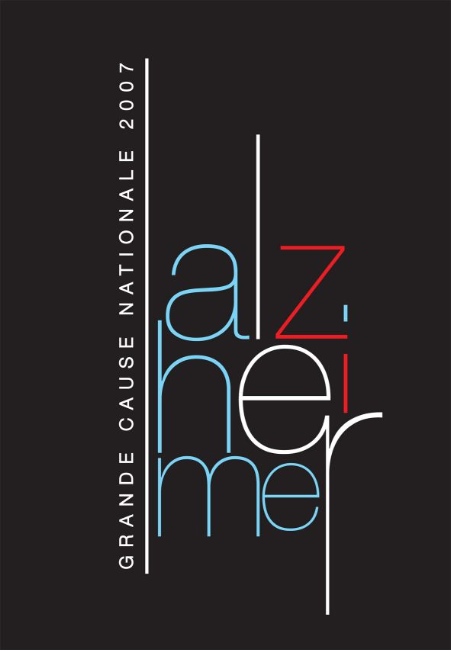
Liens externes :
France Alzheimer
Dossier consacré à la maladie d'Alzheimer, paru dans Info Science
Ministère de la Santé et des Solidarités ; consultations mémoire centres mémoire de ressources


delta7Association à but non lucratif qui a pour vocation de rechercher des solutions innovantes aux problèmes sociaux et de les expérimenter en vue de développer leur généralisation.
Les Français et la maladie d'Alzheimer
Liens internes :
Soin, qualité de vie et bonheur
Ceci est mon corps
Du soi-niant au soignant
La meilleure des machines ne vaut pas une poitrine
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme
La vérité est-elle bonne à dire ?
Peut-on oublier que l'on va mourir ?
La nouveauté
Je ne sais pas d'avance mais j'avance
La folie
Commentaires
Ajouter un commentaire